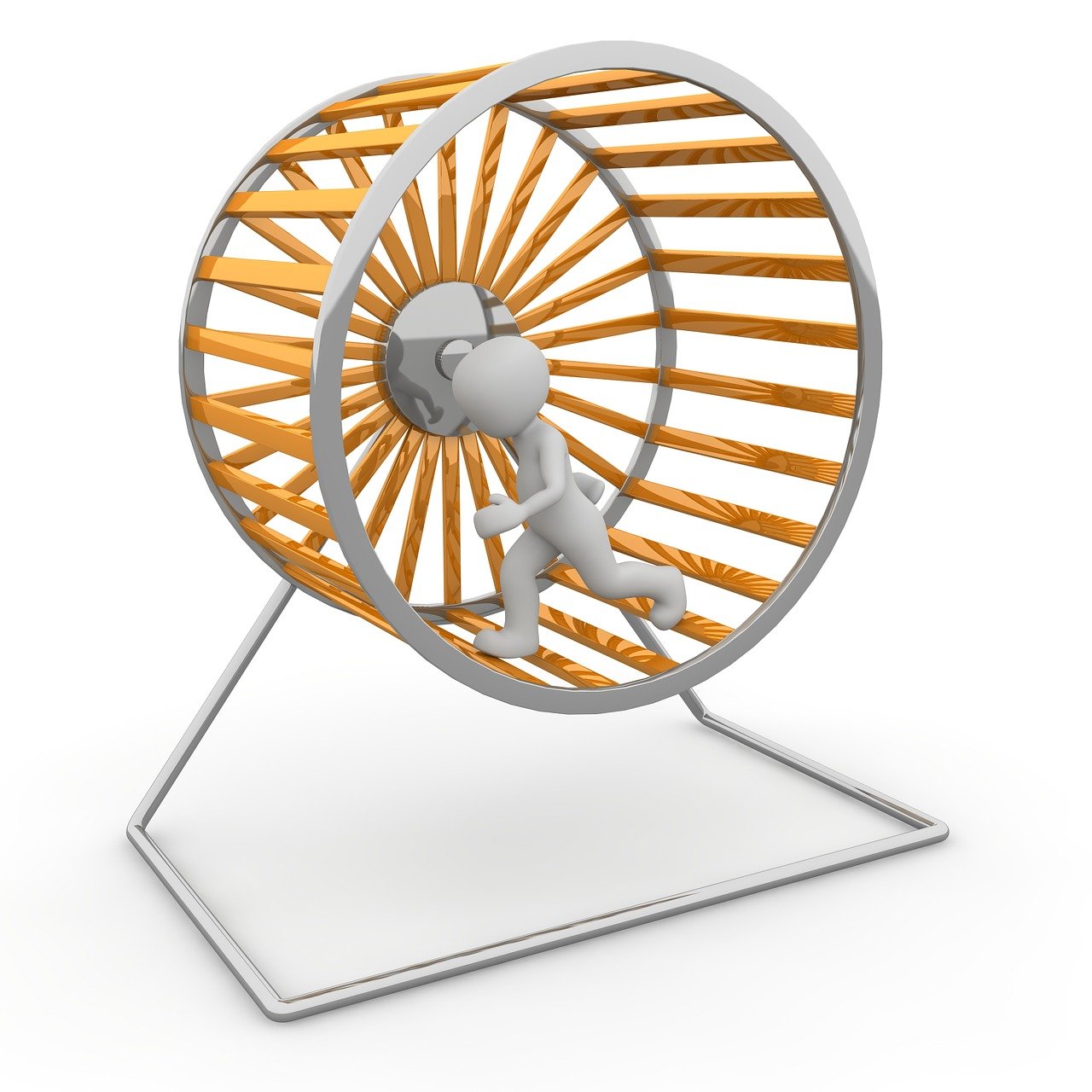Je ne peux ni ne dois m’en plaindre, car je suis vivant.
Je n’ai pas fui les bourreaux, je n’ai pas été traqué. Mais mes grands-parents, mes tantes, mes cousins, eux, ont été engloutis dans les ténèbres. Avec eux, plus d’un million d’enfants, de femmes et d’hommes ont péri dans des atrocités innommables : le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994.
Je fais partie de ceux qui ont vu, de loin ou de près, l’onde de choc du chaos. D’une génération arrachée trop tôt à l’enfance, une génération qui a grandi trop vite, marquée à jamais. Pourtant, je ne me considère ni comme un survivant, ni comme un héros. Mes proches ont payé un prix bien plus lourd. Un prix que je n’ai pas su, ou pu, éviter.
La vie à Goma : avant la tempête
En 1994, ma vie ressemblait à celle de tous les adolescents de mon âge. J’étais à Goma, au Zaïre, loin — du moins le croyais-je — des violences du Rwanda voisin. Mes journées étaient rythmées par l’école, les amis, et les jeux dans la rue. J’avais 12 ans, presque 13. J’étais insouciant. Mais cet équilibre allait s’effondrer.
Le matin du 7 avril : la fin de l’innocence
Il était 5 heures du matin lorsque ma mère nous réveilla, en pleurs. Elle prononça une phrase que je n’oublierai jamais : « Personne ne survivra. »
Je me souviens de ce moment comme d’un coup de tonnerre. Nous étions déstabilisés. Moi, je ne voulais pas y croire. La mort et la souffrance me semblaient encore lointaines, irréelles.
On m’avait appris à me taire et à écouter les adultes. Et pourtant, ce jour-là, je les voyais désarmés, dépassés. Ma mère pleurait, murée dans une détresse que je ne comprenais pas.
Kigali n’était qu’à trois heures de route. Nos familles y vivaient. Mais malgré les rumeurs, malgré la peur, je croyais encore que la communauté internationale interviendrait. Je pensais que les « Blancs », l’ONU, les humanitaires viendraient sauver les nôtres.
Nous n’avions pas de télévision. Les nouvelles venaient des radios. Elles parlaient de massacres. Mais les mots n’étaient pas encore à la hauteur de l’horreur.
La violence s’installe : l’horreur à nos portes
À Goma, le vent du génocide passait presque inaperçu. On parlait de guerre, pas de génocide. Pour la majorité, c’était l’indifférence.
La vie suivait son cours : les adultes allaient travailler, les enfants à l’école. On jouait toujours dans les rues. Mais pour nous, ceux qui avaient de la famille de l’autre côté, chaque jour était un cocktail amer d’espoir, de tristesse et de confusion. Les nouvelles étaient rares, souvent floues, parfois contradictoires.
Moi, je m’accrochais à une foi naïve. Je croyais encore que mon père, chauffeur de métier, pourrait faire les trois heures de route, aller chercher nos proches, et revenir avec eux. Comme si tout cela était encore possible.
Le lac Kivu : les corps flottent
Puis, il y eut les corps. Le lac Kivu les rejetait chaque matin, parfois entiers, parfois démembrés. Je me suis demandé : Et si c’était eux ? Ma grand-mère ? Mes cousines ? Mes tantes ? Je tentais de me rassurer, en me disant qu’ils étaient loin du lac. Jusqu’au jour où j’ai appris que les rivières de Kigali se jetaient dans le Kivu. Ce jour-là, je n’ai plus pu me mentir.
L’eau du robinet avait une odeur étrange, presque insoutenable. On faisait bouillir l’eau, pensant que ça suffirait. Mais à chaque gorgée, je ne pouvais m’empêcher de penser que l’eau avait peut-être porté des cadavres. La mort était partout, dans l’air, dans l’eau, dans les regards.
L’Opération Turquoise : l’espoir déçu
Puis l’Opération Turquoise arriva. Au début, j’y ai vu un espoir, un dernier souffle. Je croyais que les soldats français pourraient sauver mon papi, ma mami, mes tatas, mes cousins et mes cousines. J’avais l’impression que cette intervention internationale allait mettre fin à l’horreur et protéger nos proches.
Je les ai croisés, ces soldats. Nous avons échangé, et pendant un instant, j’ai cru que tout allait changer. J’étais persuadé qu’ils viendraient au secours des nôtres, qu’ils protégeraient ma famille et les ramèneraient en sécurité.
Mais ce qui semblait être une lueur d’espoir ne fit que souligner l’absence de véritable soutien. L’illusion d’une protection se transforma en désillusion, car, malgré leur présence, la réalité était bien plus cruelle que ce que j’avais imaginé.
Les réfugiés arrivent : une fuite sans fin
Le 2 juillet 1994, des milliers de réfugiés déferlèrent sur Goma. Parmi eux, des innocents, des victimes. Mais aussi des bourreaux.
Des miliciens, des soldats, des responsables de massacres. Ils fuyaient, non par peur des bombes, mais pour échapper à la justice. Ils prenaient les civils en otage, les enfermant dans les camps, les soumettant à leur loi.
Ce jour-là, la réalité de la situation m’a frappé de plein fouet. En traversant la colonne de réfugiés, j’ai croisé une femme portant son bébé dans le dos. Sans y réfléchir, j’ai alerté la dame en kinyarwanda, ma langue maternelle, en lui signalant que le bébé n’était pas correctement positionné.
Le milicien qui l’accompagnait s’est retourné. Il avait une machette. « Ils nous ont suivis, les inyenzi !» a-t-il crié.
Ce mot — inyenzi — m’a glacé. Je savais ce qu’il signifiait. La haine. La traque. Le danger.
Je me suis éloigné. J’ai fui. Je me suis faufilé parmi la foule. Je ne pouvais plus regarder. Je me suis retourné de loin, et j’ai vu cette scène figée, irréelle. Ce moment me hante encore aujourd’hui.
La dame a détaché son bébé de son dos. Elle l’a observé un instant, puis l’a enveloppé dans un tissu et l’a posé délicatement sur le sol. Le bébé était mort.
À ce moment-là, je me suis retrouvé envahi par une profonde compassion pour cette mère, une mère qui venait de perdre son enfant. Mais dans le même temps, je ressentais une sorte de robotisation en elle, comme si elle était incapable de réagir autrement à ce moment terrible.
Ma mère et les ex-FAR : le désespoir en action
Un jour, des officiers ex-FAR vinrent chez nous. Toujours en uniforme. Comme s’ils n’avaient jamais quitté leur poste. Comme si la guerre leur appartenait.
Ma mère les avait fait venir. Non par sympathie, mais par besoin. Elle voulait des réponses. Elle voulait savoir. Même si cela signifiait parler à ceux qui avaient peut-être du sang sur les mains.
C’était une forme de résistance. Une tentative désespérée de reconstruire des morceaux de vérité, d’obtenir une information, un indice. Une lueur, même infime.
La procession vers le monastère de Buhimba : marcher pour survivre
Les camps de réfugiés se sont installés tout autour de Goma : Mugunga, Katindo, Buhimba…
J’ai traversé Mugunga une fois, lors d’une marche de la croix. J’étais servant de messe, et nous devions accompagner l’évêque.
En entrant dans le camp, j’ai vu la haine dans les yeux des gardiens : ex-FAR, Interahamwe… J’ai compris que l’Église ne nous protégerait pas.
J’ai courbé l’échine. J’ai prié… je crois.
Hommage
Je dédie ce récit à papi, Mami, mes tatas, mes cousines — dont Nana —, mes cousins Garga et Daddy, et à toutes les victimes du génocide des Tutsis.
Ce témoignage est un acte de mémoire, de justice, de résistance.
Pour qu’on n’oublie jamais.
Pour qu’ils vivent, à travers mes mots.
Turibuka Twiyubaka.